XXe-XXIe siècles
-
David ARNOLD,
Cyprian BLAMIRES,
Karel BOSKO,
Marcel COTTIER,
Gérard DANOU,
Frank DIKÖTTER,
Max ENGAMMARE,
Jean-Claude FAVEZ,
Yasmina FOEHR-JANSSENS,
Laurence GUIGNARD,
Timothy HARDING,
Mark HUNYADI,
Romano LA HARPE,
Arielle MEYER,
Alessandro PASTORE,
Michel PORRET,
Beat RÜTTIMANN,
Fernando VIDAL,
Jean WIRTH
Moyen Âge chrétien, Europe moderne et contemporaine, sociétés coloniales: ces études originales apportent un regard interdisciplinaire sur cet objet central des sciences humaines qu'est le corps, abordé ici sous la thématique de la violence concrète et de son imaginaire social ou littéraire. Religieuses, pénales, militaires, concentrationnaires, pathologiques et aussi thérapeutiques: les violences du corps trouvent une actualité singulière en cette fin de XXe siècle. Elles font parfois écho, après les camps nazis, aux guerres civiles ou à la purification ethnique, laboratoires de l'anéantissement corporel et de la déshumanisation. Textes de: David Arnold; Cyprian Blamires; Karel Bosko; Marcel Cottier; Gérard Danou; Frank Dikötter; Max Engammare; Jean-Claude Favez; Yasmina Fœhr-Janssens; Laurence Guignard; Timothy Harding; Mark Hunyadi; Romano La Harpe; Arielle Meyer; Alessandro Pastore; Michel Porret; Beat Rüttimann; Fernando Vidal; Jean Wirth.
-
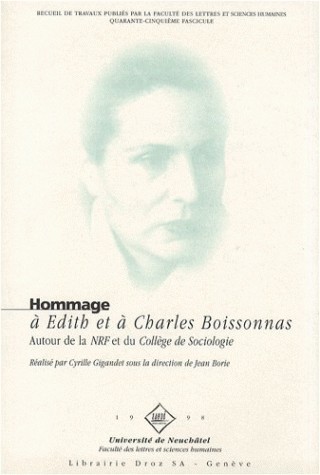
Cet aperçu des débuts littéraires d'Edith Boissonnas a été réalisé à partir de deux sources importantes de ses archives: son Journal pour moi seule et le début de sa correspondance avec Jean Paulhan, dont l'édition critique complète est en cours. La suite de sa carrière a été évoquée au moyen d'une sélection de poèmes, tirés de tous les recueils qu'elle a publiés, jusqu'au dernier, paru dans la revue Le Nouveau Commerce en 1985. Un autre poème, de Jacques Chessex, dresse un portrait-mémoire d'Edith Boissonnas. L'évocation de Jean Borie, imprégné de l'esprit des livres et des revues de sa bibliothèque, suggère le climat intellectuel, social et littéraire dans lequel elle a vécu. Dans son introduction, Francis Persoz, recteur de l'Université de Neuchâtel, revient sur les circonstances de l'héritage d'Edith Boissonnas, dont l'Université a bénéficié, et énumère les mesures prises pour le sauvegarder. L'ensemble du volume d'Hommage à Edith et Charles Boissonnas est illustré au moyen de documents tirés des archives ou de la bibliothèque d'Edith.
-
Cette "expérience" spirituelle est celle d'une émergence de l'Infini dans la finitude: "L'homme n'est pas, mais l'Etre est son œuvre". La mutilation du poète, reconnue comme stigmate d'une déchéance dont l'homme serait le fruit, n'a jamais servi que d'aiguillon dans cette quête. Procédant à un audacieux renversement des apparences, Bousquet intériorise et abolit l'espace, le temps, les causes qui règnent à la surface du monde manifesté. Il découvre, au cœur de l'homme même, et à l'origine de tout, l'Etre infini que chacun est "sans le savoir". Ennemi des spéculations abstraites, il ne conçoit cet Etre que doué de la plus haute densité matérielle. Il le poursuit à travers l'amour, tentative de restauration de l'androgyne cosmique, et la poésie, où la parole retrouve la chair et redevient le Verbe même.
-
A la veille du bicentenaire de la naissance de Prosper Mérimée en 2003, Pierre H. Dubé a organisé et analysé les très nombreuses études qui ont été consacrées à l'écrivain, à l'homme d'Etat et à l'archéologue depuis 1825, année de la publication des premiers articles sur le Théâtre de Clara Gazul. Cette bibliographie recense non seulement les monographies consacrées à Mérimée, mais aussi un très grand nombre d'articles de périodiques, de journaux, des éditions spécialisées, des chapitres dans des mélanges, des thèses inédites, et des mémoires de ses contemporains. Etendue sur un siècle et demi, elle comprend plus de deux mille entrées.
-
L’écriture aphoristique de ce siècle se situe dans le prolongement d’un ensemble de traditions gnomiques et sentencieuses que l’on peut faire remonter jusqu’à l’Antiquité la plus haute. La première partie est ainsi consacrée à l’histoire des genres sentencieux et de l’écriture discontinue, et en particulier à l’avènement de la maxime classique. C’est dans la descendance directe de la maxime, dans son infléchissement vers la contingence et la subjectivité, qu’il convient de cerner l’émergence d’un genre moderne de l’aphorisme, où la question de la vérité dans le discours discontinu, notamment au travers de la «révolution» surréaliste, prend un tour radicalement problématique. Dans la seconde partie du livre, l’hypothèse d’une spécificité relative de l’aphorisme moderne comme ressaisissement de la tradition est mise à l’épreuve dans des études monographiques consacrées à cinq auteurs de première importance pour le genre: Cioran, Reverdy, Scutenaire, Jourdan et Chazal.
-
D'où vient ce qui s'écrit? Quelle est part de l'Autre en soi lorsqu'on fait acte de création? La figure de l'ange passe dans l'œuvre pour évoquer le mystère de l'inspiration. Et souvent, un peu en retrait dans sa réserve de silence, nous découvrons devant lui la présence d'une figure virginale qui lui offre l'espace d'accueil et d'écoute sans lequel l'œuvre virtuelle ne peut se créer dans la matière. L'ange et la vierge invitent à de secrètes identifications avec les figures de l'absence, et à une approche souvent critique de l'accomplissement. Mythe de genèse illuminé par l'Enfant-Œuvre, l'annonciation met en scène les dynamiques du désir qui opèrent au cœur même de l'acte créateur, qu'il soit de corps ou d'esprit. Car l'art et l'amour ne cessent de s'interpeller dans les scènes d'annonce que nous pouvons lire, des Secrets de la princesse de Cadignan de Balzac aux Charmes de Valéry, en passant par Baudelaire, Mallarmé, Cocteau, Rilke et Benjamin.
-
-

L’œuvre d’Antonin Artaud donne à lire sinon la cohérence, du moins la permanence et l'urgence vitale de la quête énonciative qui impulse son écriture si profuse, et en apparence si hétéroclite. C’est en effet le mode de structuration psychotique de la personnalité d’Antonin Artaud qui module et dynamise les variations si spécifiques de son énonciation. En repérant dans chacun de ses textes la spécificité de l'agencement et de la dissolution des signes, ce livre tente de comprendre comment et pourquoi ce même auteur a pu écrire, à des époques très diverses de son existence et dans des conditions énonciatives extrêmement variées, tantôt des textes qualifiés de pathologiques et d'illisibles, tantôt des textes reconnus comme œuvres littéraires.
L'aventure de l'écrivain a ceci d'extraordinaire qu'elle a été vécue à la fois dans et contre le langage. Avec une lucidité aussi cruelle que remarquable, et au prix d'innommables suppliciations, Antonin Artaud pointe un éclairage intransigeant sur les leurres et l'imposture qui sous-tendent non seulement son propre discours, mais toute prise de parole, toute énonciation ...
-

Les Hommes de bonne volonté: malgré son irrésistible fonction d’appel, le titre déçoit, d’emblée. Face aux désordres et aux conflits d’un monde soumis aux cataclysmes de l’Histoire, il oppose une bien pâle vertu évangélique. Un renoncement, voire une défaite, s’inscrivent en filigrane dès l’ouverture de ce gigantesque roman dans lequel, au rebours du titre, le mal, omniprésent, s’exhibe au sein des familles comme au sein des groupes, des bandes et des sociétés secrètes. Ses formes les plus exacerbées, telles les perversions, annexent même la totalité de certains volumes, pendant que l’énigmatique Quinette, double de Landru et figure emblématique du mal, érige l’assassinat au rang de discipline intellectuelle. Les représentants de la bonne volonté assistent en spectateurs impuissants au sabbat de l’abîme, avant de tourner le dos à un monde incurable qu’ils n’espèrent plus rédimer. Le présent ouvrage a l’ambition d’évaluer les stratégies scripturales complexes mises en œuvre par l’auteur pour accréditer cette représentation fascinée du mal, et consistant en de subtils compromis avec la figure redoutable du père, le véritable manipulateur de cette machinerie du mal, caché dans les coulisses de ce vaste théâtre que sont Les Hommes de bonne volonté.
-
Né en 1719 sous la plume de Daniel Defoe, Robinson Crusoé a engendré depuis lors une innombrable postérité. Le naufragé solitaire est en effet à l'origine d'un véritable mythe, dont les littératures de la seconde moitié du XXe siècle ont su se saisir pour le transformer. Mythe moderne par excellence, puisqu'il affirme chez Defoe l'émergence du sujet de la modernité, Robinson est devenu, depuis les robinsonnades de William Golding, prétexte à une remise en cause de l'individu, à une interrogation générale sur le sens, et à une réflexion sur le mythe lui-même. Curieux paradoxe : la critique du mythe de Robinson s'opère dans des romans qui le réécrivent en en constituant de nouvelles versions. D'où une question centrale : de Golding à Coetzee, en passant par Tournier, notre époque ne s'ingénie-t-elle pas à prononcer le deuil de la modernité sur les lieux mêmes de sa naissance, dans le récit même par laquelle celle-ci s'annonçait au monde ?